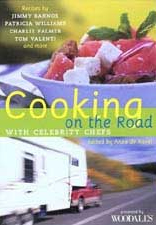Une tête blonde parmi les cornes
Cela faisait longtemps que j’avais envie de la rencontrer. Depuis que Francis, son mari, m’avait parlé d’elle et de cette vie qu’elle s’est choisie à 39 ans.
J’ai préféré un moment de l’année où c’est presque tranquille, où il y a beaucoup moins à faire. Juste avant que les femelles de son troupeau mettent bas. Laurence Nory est chevrière.

Dans la maison suédoise tout en bois, bien au chaud autour d’un café. La boîte en fer blanc pour le sucre.
La mise bas va commencer dans neuf jours. Laurence le sait car elle connaît son troupeau. Et le suit de très près. Avec amour et dévotion. Et beaucoup d’écoute et d’intuition. En attendant, donc, c’est presque une vie normale !

Avec le troupeau de race poitevine.
Le troupeau compte 28 chèvres et un bouc. Sans parler de celui qui va le remplacer et qui est pour l’instant en quarantaine.
Car Laurence n’a pas choisi la facilité. Son troupeau est de race poitevine, une race ancienne qu’elle essaye avec quelques-uns en France de relever. Il faut donc changer de bouc régulièrement pour éviter la consanguinité. Et comme il n’y a plus que 2 000 têtes de cette race, ce n’est pas tâche aisée d’en trouver des purs.
Aussi, elle ne les écorne pas car elle estime que cela leur change le caractère. Par contre, cela demande plus de vigilance car un coup de corne peut être fatal.

À midi, distribution de foin.
Et elle les nourrit bien : au foin et en complément un mélange d’orge et de pois biologiques. C’est meilleur mais cela coûte plus cher. Car elles mangent les chèvres : 3 à 4 kg de foin par jour et 3 fois 200 g de complément. Pour 3 à 4 litres de lait (contre 6 litres pour la race des alpines). Le foin c’est le sien, mais l’an dernier, à cause des pluies, elle n’a pas pu tout rentrer et a dû en acheter. Des frais supplémentaires qui n’étaient pas prévus.
Elle a des projets de semer des herbes médicinales pour que les chèvres puissent s’automédiquer. Elle les a vues faire quand elle apprenait le métier auprès d’une autre chevrière. Les chèvres, comme les grands singes notamment, savent trouver les plantes qu’il leur faut quand elles sont malades. Encore faut-il qu’elles soient en liberté pour les chercher !

À droite, l’endroit de la traite.
Le troupeau devrait passer à 45 têtes. Et Laurence ne sait pas encore comment elle va arriver à tout gérer. Avec 45, elle devrait s’en sortir mieux financièrement. Par contre, plus de chèvres à traire, et plus de lait produit, cela implique des nouveaux investissements. 20 000 €. Que le banquier a refusé de lui prêter. Les banques ne sont pas compréhensives, ni les services sanitaires d’ailleurs. Depuis le début, elle se bat pour maintenir son activité mais rien n’est acquis.
45 têtes, c’est aussi le double de travail. Car en plus de s’occuper du troupeau, Laurence fait ses fromages qu’elle vend sur les marchés des environs et par le canal des AMAP*. Pour les AMAP, elle s’engage à livrer 5 € de fromage par semaine et par panier. Mais cela implique de s’occuper aussi des livraisons et comme elle est loin de tout (à 20 km de Nemours), c’est beaucoup de temps de perdu.
Au bout de quatre ans d’exercice, le travail est toujours aussi dur, les journées aussi longues (la traite étant à 6 h 30, les jours de marché, le lever est à 4 h 30…) et on ne part pas en vacances. Mais les récompenses sont arrivées.
Le troupeau va bien : elle n’a plus de chèvres malades comme les deux premières années. Et elle a remporté 4 prix (dont 2 médailles d’or) au Concours de fromages de chèvres fermiers 2008 d’Île-de-France. Un exploit pour une toute nouvelle dans le métier. Laurence va bientôt pouvoir traire à nouveau et refaire ses fromages. Nous les attendons avec gourmandise !

Laurence au milieu de son troupeau.
Ah ! J’avais oublié de vous signaler qu’elle a appelé sa chèvrerie Missacapri. Car quand ses chèvres bêlent de concert, on dirait une messe, une vraie communion.
* Une AMAP est une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne ayant pour objectif de préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité de leur choix, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits, et de participer activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale dans le respect d’un développement durable.
Elle réunit un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité autour d’un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte des AMAP.


 Envoyer par e-mail
Envoyer par e-mail Imprimer cet article
Imprimer cet article